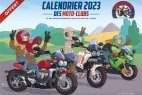Notre groupe ayant été retardé par une crevaison et diverses rencontres, tous ces gens attendent probablement sous le soleil depuis une paire d’heures. Qu’importe : dans cette région du sud-ouest du Mali encore vierge de toute forme de tourisme, un tel événement méritait bien un peu de patience. Ce soir, on dansera jusqu’à tard au son du balafon et des djembés.
Immersion
« J’ai découvert le Pays mandingue un peu par hasard, sur l’insistance d’un de mes clients médecin qui vient régulièrement y mener des opérations humanitaires », explique notre guide, Pascal Sibeyre de Randoval. « L’accueil et la gentillesse des Maliens m’ont aussitôt convaincu d’y organiser des voyages à l’écart des sentiers battus, et notamment du Pays dogon, bien trop couru. Il m’a au contraire paru nécessaire d’adopter une attitude la moins intrusive possible, et de faire en sorte que notre présence soit un minimum utile aux populations. Comme une main tendue vers l’autre. »
Car aussi hospitalière soit-elle, l’ancienne colonie française, enclavée et sans façade maritime, vit dans un dénuement séculaire qui lui vaut de se classer au 178e rang mondial de l’Indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (2009). 178e sur 182 pays analysés ; dure réalité à laquelle ces Africains de l’Ouest opposent une telle joie de vivre que leur pauvreté ne se confond pas avec la misère.
Pour nous autres Européens fraîchement débarqués d’avion, le choc est grand. Énorme, même. Ces vieilles paires de lunettes, ces chaussures d’enfants usagées ou encore ces fournitures scolaires que nous avons été invités à apporter dans nos bagages, reprennent soudain toute leur valeur. Elles seront offertes en gage d’amitié aux chefs des villages d’accueil, qui en assureront la distribution. Les médicaments, eux, ont été remis à Issa, jeune docteur qui suit le groupe en 4x4 et dont la mission consiste autant à nous rassurer par sa présence qu’à soigner les nombreux nécessiteux rencontrés en chemin. Enfin, pour que l’immersion soit totale, nos motos de marque Tonda ont été louées à Bamako, la capitale, où l’offre en deux-roues à moteurs chinois est désormais pléthorique. Des machines couleur locale, donc, toutefois moins modestes qu’il n’y paraît puisque ces copies de Honda XLS cubent 150 cm3. Un luxe quand leurs concurrentes Baotian, Star, Mesco, Royal et autres FDMO clonent plutôt la routière CB sans jamais dépasser le huitième de litre de cylindrée. Question discrétion, c’était de toute façon perdu d’avance puisqu’ici un groupe de Blancs attire immanquablement l’attention. Quand il n’effraye pas carrément les tout jeunes enfants qui, n’ayant encore jamais vu d’hommes aussi pâlots et de surcroît casqués, partent en pleurant se réfugier contre le boubou de leur mère !
Progression
Après un dernier signe d’adieu, nos hôtes d’hier disparaissent dans les rétroviseurs et le nuage de poussière que soulèvent nos roues. Le voyage se poursuit sur une terre brûlée par le soleil et légère comme de la cendre, via un immense dédale de pistes qui s’entrecroisent au hasard de leurs dégradations successives. Ici un rocher affleurant a entraîné la création d’un contournement, lui-même abandonné quelque temps après la formation de trous. Des arbres épars et une végétation clairsemée permettent généralement ce genre de fantaisie, qui contribue à rompre la monotonie d’un paysage très plat, avec une infinité de termitières comme seul relief. Choisi ta trajectoire, camarade ! Et inutile d’espérer une quelconque aide des rares panneaux qui indiquent plutôt l’antre d’un marabout local que la direction à suivre. En pratique, presque tous les chemins mènent à Kita, l’un des chefs-lieux de la région de Kayes. Une ville de 50 000 âmes desservie par la seule ligne malienne de chemin de fer qui, depuis 1924, relie Koulikoro à Dakar, Sénégal. La voilà qui barre justement notre piste, cette voie unique et quasiment en ruine, à peine annoncée par une paire de poteaux peints en rouge et blanc. Chacun ayant bien le temps de voir se pointer ce convoi brinquebalant rebaptisé avec humour TGV : train à grandes vibrations…
« Je vous suis extrêmement reconnaissant pour ce don qui va nous permettre de sauver des vies. » Aux anges, le docteur Samakoun Keïta tient dans ses mains le microscope que Pascal vient de lui remettre de la part d’un précédant groupe. Un simple microscope d’étudiant acheté sur un vide-greniers… Propriétaire d’une petite clinique privée – précision inutile dans un pays dépourvu de régime d’assurance-maladie –, Samakoun nous reçoit chez lui comme des invités de marque. Avant l’entrée en scène des griots, il s’amuse des détours que nous avons faits pour parvenir jusqu’à lui. « Vous auriez pu arriver directement de Bamako par la nouvelle route goudronnée. Avant son inauguration voilà 2 ans, il fallait 6 ou 7 heures pour parcourir ces 180 km, contre seulement 3 aujourd’hui », se réjouit-il. Avant d’ajouter, un brin fataliste : « Mais comme d’habitude, ces travaux n’ont pu être réalisés que grâce à des fonds étrangers. Car en vérité, nous fêtons cette année le 50e anniversaire de notre indépendance alors même que justement, nous ne le sommes toujours pas faute de moyens économiques. » L’appareil servant à faire les échographies qui fait la fierté de son établissement est un modèle réformé offert par un hôpital français. Et son ambulance, un ancien véhicule de pompiers qui porte encore ses logos et plaques d’immatriculation d’origine…
(Dés)Illusions
À force de vibrations et de poussière, la piste lamine tout. Aussi c’est sans surprise qu’après quelques jours de ce traitement, nos petites chinoises commencent à perdre des boulons, à sentir leurs chaînes se détendre et leur filtre à air se colmater. Mais Moussa, notre mécano attitré, reste serein : il en faut plus que ça pour l’inquiéter. Et quand c’est finalement l’arbre de transmission du 4x4 d’assistance qui finit par rompre, le jeune homme, fataliste et nonchalant, s’assoit à l’ombre et attend que la providence veuille bien l’aider à desserrer les écrous récalcitrants. C’est l’Afrique, patron ! Rien ne presse, du moins tant que l’on n’est pas exposé à l’un des nombreux feux de brousse allumés pour défricher et fertiliser les terres, voire pour débusquer du gibier. En fait de phacochère, il est plus probable de déranger un vélo garni de poulets ou une 125 au chargement vertigineux. Plus rarement un taxi-brousse (également appelé Sotrama), ancienne camionnette souvent sans vitre et si pleine à craquer qu’elle trimbale quelques chèvres et passagers supplémentaires sur son toit. Scène ordinaire du quotidien des Maliens, qui n’accèdent que par petites touches au progrès et à l’amélioration de leurs conditions de vie.
Animés d’une farouche volonté de s’en sortir, d’aucuns émigrent vers une Europe aux faux airs d’Eldorado. D’autres se contentent de faire un peu de contrebande avec la toute proche Guinée, d’où la présence de ces motos flambant neuves qui coupent parfois à travers brousse pour éviter d’hypothétiques douaniers. Certains, enfin, s’improvisent orpailleurs dès qu’un nouveau filon du précieux métal est découvert dans les environs. Sachant que le Mali contient paradoxalement dans son sous-sol les troisièmes plus grosses ressources d’or d’Afrique ! Ils sont ainsi plusieurs centaines d’hommes, de femmes et même d’enfants à vivre dans un camp de fortune un peu à l’écart de la piste de latérite qui mène à Kangaba. Plusieurs centaines à avoir, dans des conditions de travail d’un autre âge, transformé le site en ce qui ressemble désormais à une vaste termitière. À plus de 10 m sous terre, l’inquiétude n’est pas tant qu’une galerie mal étayée s’écroule mais plutôt qu’une multinationale ne vienne mettre la main sur une concession qui, bon gré mal gré, rapporte 40 000 francs CFA mensuels à chaque mineur. Soit une soixantaine d’euros…
Réflexion
Là où aurait dû se trouver le fleuve, il n’y a plus qu’une immense plage de sable doré dans laquelle nos roues s’enlisent. À l’approche de la saison chaude, le Niger – qui n’en est pourtant qu’au début de son long cours – se réduit comme peau de chagrin, victime de l’évaporation et de l’ensablement. Sa traversée nécessite cependant d’embarquer les motos sur une pinasse, pirogue traditionnelle du peuple Bozo qui supplée à la rareté des ponts : à peine 4 sur les 1 700 km que parcourt le fleuve au Mali. Sur l’autre berge nous attend l’un de ces énormes baobabs à l’ombre desquels il fait si bon s’arrêter et méditer sur l’ordre du monde. Sur le fait que ce sont souvent ceux qui possèdent le moins qui sont prêts à vous en offrir le plus, et avec le sourire de surcroît. Sur le fait que l’Afrique marche elle aussi, bien qu’à son propre rythme, sur la voie de la modernisation. Les Chinois, omniprésents ici, sont notamment en train de goudronner la piste qui nous ramènera demain à Bamako. Dommage que pour aller le plus droit et le plus vite possible, ils aient abattu les dizaines de caïlcedrats qui bordaient l’ancienne voie. Sous ces immenses acajous se sont probablement déroulés plus de palabres que n’en supporte désormais la mondialisation.